 Suite à la première phase qui s’est tenue en 2003 à Genève,
c’est à Tunis que se tiendra, dans un peu plus d’un an, du 16 au 28 novembre
2005, la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de
l’Information.
Suite à la première phase qui s’est tenue en 2003 à Genève,
c’est à Tunis que se tiendra, dans un peu plus d’un an, du 16 au 28 novembre
2005, la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de
l’Information.La fracture numérique – Faits et méfaits
A paraître quelque part
Par Mohamed Louadi, PhD
 Suite à la première phase qui s’est tenue en 2003 à Genève,
c’est à Tunis que se tiendra, dans un peu plus d’un an, du 16 au 28 novembre
2005, la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de
l’Information.
Suite à la première phase qui s’est tenue en 2003 à Genève,
c’est à Tunis que se tiendra, dans un peu plus d’un an, du 16 au 28 novembre
2005, la deuxième phase du Sommet Mondial sur la Société de
l’Information.
La fracture numérique sera parmi les thèmes les
plus importants qui y seront discutés. Beaucoup en parlent mais peu nombreux
sont ceux qui réalisent, sinon le sens, du moins l’importance de ses
implications à long-terme. Si l’on se limite à la définition de la fracture
numérique quand elle est liée aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), une revue rapide de la littérature consacrée à ce thème
fait ressortir au moins quatre définitions 1:
Un décalage (gap) dans l’accès aux TIC, mesuré en termes de nombre ou de pénétration de lignes téléphoniques (télédensité) ou d’ordinateurs.
Un décalage dans la capacité à utiliser les TIC, mesuré en termes de compétences et la présence d’autres mesures éducatives.
Un décalage dans l’utilisation proprement dite des TIC,
mesuré en termes de minutes de communication, heures de présence devant un
poste téléviseur, le revenu du commerce électronique, par
exemple.
Un décalage dans l’impact de l’utilisation des TIC,
mesuré en termes de retombées financières ou économiques.
La locution «fracture
numérique»2
se réfère en fait à plusieurs phénomènes
différents. Elle peut se référer à l’accès et à l’utilisation inégaux de
l’Internet. Elle peut aussi se référer à l’incapacité d’utiliser l’Internet due
non seulement à l’accès mais à d’autres facteurs dont le niveau d’instruction,
la langue, etc.
Malgré le flou de sa définition, la notion de
fracture numérique est l’une des plus discutées au cours de la décennie écoulée
et fera sans doute couler beaucoup d’encre encore.
Elle est discutée tant au niveau national qu’à
celui international et beaucoup croient qu’elle n’est qu’une re-formulation de
la notion du dialogue nord-sud ou de la différence économique entre les pays
pauvres et les pays riches.
Pour mieux comprendre la notion de fracture
numérique, peut-être sera-t-il utile de la repositionner dans son contexte
historique d’évolution.
Au cours de l’histoire de l’humanité, chaque
époque a eu un problème à résoudre. Pour l’ère agricole, ce fut (et est encore
pour certains pays) le problème de nourrir les masses. Pour l’ère industrielle,
le problème était de nantir les masses de bien-être matériel.
A présent, l’humanité fait face à l’ère de
l’information dont les préoccupations majeures sont la disponibilité et l’accès
universels à l’information et au savoir qu’elle peut induire. Au cours des deux
ères précédentes, l’humanité est passée d’une phase de rareté (famine, pauvreté,
ignorance) à une ère de sur-abondance. Les pays dits avancés sont déjà en train
de subir les conséquences de la surabondance: nourriture et problèmes d’obésité
et autres maladies aux États-Unis, richesses matérielles et problèmes de
pollution dans les sociétés industrialisées.
Cette ère de
l’information est tout à fait particulière et a des manifestations inédites. A
titre d’exemple, en 2002, les industries du
papier, des films, des supports magnétiques et optiques avaient produit quelque
5 exa-octets de nouvelles informations3.
92% de ces informations nouvelles sont conservées sur des supports
électroniques, essentiellement des disques magnétiques et 0,01% sur papier.
A eux seuls, les États-Unis produisent 40% de
ces informations. La population mondiale étant actuellement estimée à un peu
plus de 6,4 milliards, on estime que la quantité d’informations produite chaque
année est de 800 mégaoctets par personne (l’équivalent de 9 mètres de livres
juxtaposés). L’augmentation annuelle du stock d’informations a été estimée à 30%
entre 1999 et 2002. Or ces calculs ne concernent pas vraiment toute la
population de la planète.
Selon certaines autres estimations, le trafic
généré par l’Internet doublera annuellement entre 2002 et 2007 de 180 à 5.175
péta-octets par jour4
Ce trafic sera généré à 60% par les individus et 40% par les entreprises. Encore
une fois, ce ne sont pas tous les individus et toutes les entreprises de la
planète qui sont concernés par ces statistiques. Certains n’en sont que
consommateurs passifs. D’autres en sont totalement exclus.
|
|
|
| L’Internet et l’univers global? Une personne sur 22 était connectée à l’Internet en 1999. En 2002, le ratio s’éleva à 1 sur 10. Déjà, le ratio se rapproche de 1 sur 8 en 2004. En effet, considérant que la population mondiale actuelle est de 6,453,311,067 et que la population Internet compte 745,353,098 Internautes, on conclut que 11,5% de la population mondiale utilise l’Internet. L’«explosion» spectaculaire de l’Internet, quand elle est placée dans la perspective de l’explosion démographique de la planète, n’a vraisemblablement pas encore engendré le Village Global tant médiatisé. | |
Car dans d’autres
régions du monde, les préoccupations sont tout autres. Les enjeux sont souvent
encore ceux de l’ère industrielle, voire même de l’ère agricole. Alors que
pendant les années 1990, la proportion des
personnes souffrant d’extrême pauvreté monétaire est tombée de 30 à 23 %,
la moitié de la population mondiale vit encore
d’un revenu quotidien inférieur à deux dollars et plus de 1,2 milliard de
personnes survit avec moins de un dollar par jour. Selon le rapport du PNUD de
2003, une proportion plus importante de la
population souffre encore de la faim dans 21 pays. En fait, 54
pays sont aujourd’hui plus pauvres qu’en 1990. Dans 14 de ces pays, les enfants
sont plus nombreux à mourir avant l’âge de cinq ans.
Des statistiques existent aussi à propos de
l’accès aux médias et aux technologies. En 1999, près de deux milliards
d’individus n’ont jamais passé un appel téléphonique5.
Aujourd’hui, plus de 4,5 milliards de personnes sont encore privées de
téléphone, le tiers de la population mondiale ne sont pas reliés à un réseau
électrique, ce qui les exclut d’entrée de jeu de toute participation à quelque
conception de la société de l’information que ce soit.
Les vastes quantités d’informations, la quantité
de recherches et de développements sous-jacents qualifient l’ère dans laquelle
nous vivons comme étant l’ère numérique, l’âge de l’information. Nous vivons une
époque inédite car dans aucune autre il n’y a eu autant d’appareils et de
machines organisés, interconnectés par un réseau aux dimensions planétaires et
dont le but et de fournir encore plus d’informations qu’aucune société ne peut
interpréter, pas même la société de l’information.
D’un autre coté, le nombre d’utilisateurs de
l’Internet a augmenté de 92% entre 2000 et avril 2004, une progression
relativement ralentie si l’on estime cette augmentation à 119% entre 1999 et
2002 allant de 276 à 605 millions selon les estimations du World Economic Forum
2003. Plus significatif encore, le nombre mondial d’Internautes a depuis
quelques temps dépassé le nombre de PC. Alors qu’il y avait 550 millions de PC
dans le monde en 2002, le nombre d’Internautes avait dépassé 590 millions au
cours de la même année.
|
|
| Certaines technologies (téléphone portable, Internet, ordinateur) semblent exhiber une tendance d’adoption par les ménages américains qui est en fonction du revenu annuel. Mais plusieurs autres facteurs sont également à considérer, dont, le niveau d’instruction, le fait que la résidence soit dans une zone urbaine ou rurale, le type de famille (présence ou non d’enfants en âge d’aller à l’école, au collège ou au lycée), etc. |
Aujourd’hui, les pays engagés dans l’ère de
l’information doivent déjà penser à faire face à la surabondance de
l’information et aux problèmes d’anxiété et de stress qu’elle engendre déjà dans
certaines contrées de la planète.
Pour les laissés-pour-compte, ou les have-nots,
le défi est encore plus immédiat car tout ce qui est nécessaire à l’entrée dans
la nouvelle ère, les lignes de téléphone, l’électricité, les micro-ordinateurs,
l’éducation et l’alphabétisation, y fait défaut. En Ethiopie, le prix d’un PC
équivaut à 15 fois le produit intérieur brut par habitant6.
L’anecdote selon laquelle il existe plus de lignes de téléphone à Manhattan que
dans toute l’Afrique sub-saharienne a plusieurs fois fait le tour du monde.
Alors qu’en 2002, les États-Unis disposaient de 645 lignes de téléphone pour
1.000 habitants, la République Démocratique du Congo n’en avait que 0,38 et le
Tchad 1,5.
Malgré
les évolutions rapides, mais ralenties entre 2001 et 2002, la population
Internaute mondiale est actuellement estimée à plus de 745 millions. 10
millions (1,25% du total) sont en Afrique, dont 30% sont en Afrique du Sud
et 17% en Afrique du Nord.
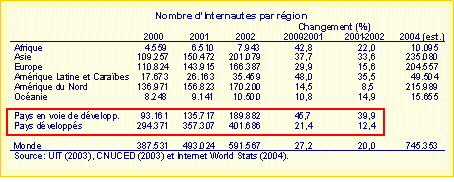
Si de l’ère agricole,
nous sommes passés à l’ère industrielle puis à l’ère de l’information (pour
déboucher peut-être sur l’ère du savoir et enfin sur l’ère de la sagesse), le
rapport entre le revenu des pays riches et celui des pays pauvres est passé de 3
à 1 en 1820, à 35 à 1 en 1950, à 44 à 1 en 1973
et à 70 à 1 en1992.
|
|
| Aujourd’hui, 209 pays sont connectés à l’Internet. Cela ne veut nullement dire que la fracture est en train de se rétrécir ni que l’usage que ces pays font de l’Internet leur soit également profitable. En 2003, seul un pays, l’île de Tokelau dans le Pacifique, s’est connecté à l’Internet. |
Le revenu moyen des 20 pays les plus riches est 37 fois
supérieur au revenu moyen des 20 pays les plus pauvres, un fossé qui a doublé au
cours des 40 dernières années. Dans les années
1990, la croissance du revenu moyen par habitant a été inférieure à 3% dans 125
pays en développement et en transition, et dans 54 d’entre eux, le revenu moyen
par habitant a reculé. Sur ces 54 pays, 20 se trouvent en Afrique subsaharienne
et 5 sont des pays arabes.
Ce qui nous laisse
nous demander si le fossé numérique est en train de s’élargir ou de se
rétrécir?
|
|
|
|
| La faible intégration économique des régions du monde est visible dans l’importante des bandes passantes transportant voix et données. L’Amérique du Nord est très plus fortement connectée à l’Europe, et à un moidre degré, à l’Asie, mais très peu à l’Amérique latine et encore moins à l’Afrique. L’Afrique est d’ailleurs très peu connectée avec l’Europe, pourtant plus proche (Source: Global Internet Map, Telegeography, Inc., 2001). |
Les économies émergentes se doivent,
malgré leur peu de ressources, de bénéficier des évolutions technologiques afin
de les exploiter effectivement et accélérer leur développement. La fracture
numérique, si elle persiste, conduira à l’issue contraire. Les espoirs sont
permis grâce notamment à la chute des prix, la croissance du marché des services
qui devrait atteindre un trillion de dollars à la fin de 2005. La popularité
croissante du logiciel libre devrait permettre un saut en avant considérable.
Tout cela pour nous permettre de nous intégrer dans l’économie mondiale en
commençant de prendre part à la révolution du commerce électronique, promis à un
chiffre d’affaires global de 3 trillions de dollars à la fin de
2005.
Or pour pouvoir aspirer à cela, un pré-requis
est absolument nécessaire : l’accès à l’Internet. Et pour cela, l’accès aux
autres TIC, dont l’ordinateur, est incontournable. Cela est semble-t-il en train
de se faire à juger par le nombre croissant de pays connectés à l’Internet.
Les débats sur la
fracture numérique n’ont jamais précisé clairement si ce sont les TIC qui créent
la richesse ou si c’est la richesse qui permet de s'équiper en TIC. Mais il y a
une association implicite entre richesse et TIC. Mohamed Mahatir, ex-Premier ministre de Malaisie
le signifie bien en déclarant en 2000: «It can be no accident that there is
today no wealthy developed country that is information poor and no information
rich country that is poor and under-developed»7.
3. 5 exa-octets équivalent à 500.000 bibliothèques de la taille de celle du Congrès américain dont le patrimoine est évalué à plus de 19 millions de volumes.
4. Un péta-octet est égal à 250 octets. Cette estimation signifie que d’ici à 2007 les échanges sur l’Internet équivaudront au contenu de livres rangés côte à côte sur une distance de 54 millions de kilomètres (un peu moins que la distance de la Terre à la planète Mars) échangé tous les jours.
5. La moitié de la planète n’a jamais utilisé le téléphone. C’est en février 1995, lors de la conférence ministérielle du G7 tenue à Bruxelles, que Thabo Mbeki, alors vice-président de l’Afrique du Sud, fit la déclaration que plus de la moitié de l’humanité n’avait jamais composé un numéro de téléphone et qu’en fait, il y avait plus de lignes de téléphones à Manhattan que dans toute l’Afrique sub-saharienne. Il la reprit en 1996 dans un discours qu’il donna à l’occasion de Information Society and Development Conference. La déclaration fut reprise en 1998 dans un rapport de l’Union Internationale des Télécommunications qui y ajouta les statistiques suivantes: l’Afrique représentant 12% de la population mondiale, ne dispose que de 2% des lignes de téléphone avec une télédensité aussi faible que 2% du réseau mondial (comparé à 48 en Asie, 280 en Amérique, 314 en Europe et 520 dans les pays à revenus élevés).La même année, en 1998, le vice-président américain Al Gore l’utilisa dans ses discours. Elle fut encore une fois reprise par le quotidien populaire américain USA Today dans sa livraison du 25 octobre 1999 et, en 2000, c’était au tour du président de la Federal Communication Commission (FCC) Reed Hundt. Elle fut également utilisée en 2001 par le PDG de Hewlett Packard, Carly Fiorina et par Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies lors du World Economic Forum de Davos. Dans certaines versions, on voit Tokyo ajoutée à Manhattan. Quoique sans cesse répétées, ces statistiques n’étaient fondées qu’en 1994, lorsque Greg LeVert de MCI la déclara pour la première fois lors de TeleCon 94 tenu à Toronto (Voir Shirky (2002). Sorry, Wrong Number, Wired Magazine, Issue 10.10, octobre, www.wired.com/wired/archive/10.10/, consulté le 30 mars 2004.).